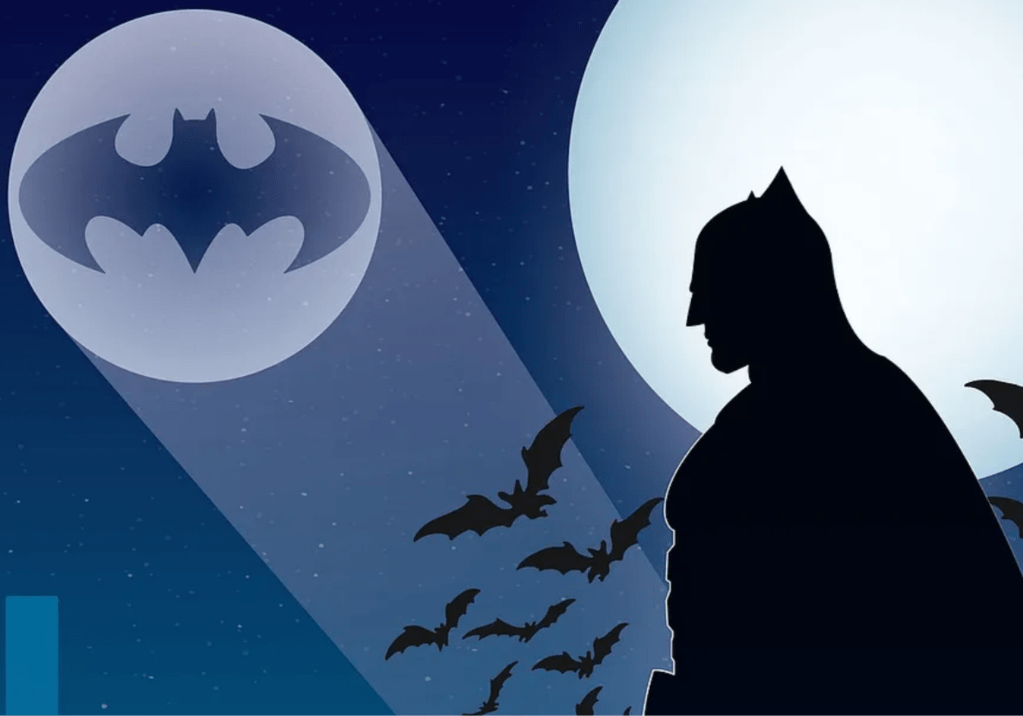Né en 1939, le chevalier noir n’est pas qu’un personnage de fiction. Sa création raconte les tourments d’une population traumatisée par la Grande Dépression, qui mobilise Batman contre des fléaux bien réels : le grand banditisme et la misère sociale…
Un playboy multimillionnaire qui se travestit en chauve-souris pour cogner, de nuit, sur la pègre de Gotham ; à première vue, Batman n’est rien d’autre qu’un super-héros névrosé avec un penchant pour le latex. Et pourtant, son histoire nous raconte, en pointillés, l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire américaine. Flashback en 1929. Le 24 octobre, pour être précis, « jeudi noir » qui fera date. Ce jour-là, le krach retentissant de la bourse de Wall Street – neuf milliards de dollars partis en fumée en l’espace d’une heure et demie – précipite la ruine de milliers de petits porteurs. Du jour au lendemain, des centaines de foyers se retrouvent sans un sou. « On doit faire la queue pour trouver une fenêtre depuis laquelle se jeter » rapporte un journal satirique new-yorkais. L’idée reçue veut que banquiers et investisseurs ruinés se soient aussitôt hissés au sommet des gratte-ciels de Manhattan, prêts pour le grand plongeon qui est aussi celui de l’économie américaine… En réalité, la seule silhouette qui hante les toits de New York à cette époque, préparant son entrée fracassante, c’est celle de l’homme-chauve-souris.
Nuits blanches à Gotham
Le « jeudi noir » de 1929 n’était que le début. Comme un poison, la crise infecte bientôt le reste de la planète. Les États-Unis s’enfoncent alors dans une crise profonde – c’est la Grande Dépression – qui ne s’achèvera que dans les années 1940 grâce aux efforts du président Franklin D. Roosevelt. Un quart de la population est toujours sans emploi en 1933, et il faudra attendre 1936 pour retrouver les niveaux de production d’avant la crise… Pour la majorité de la population, une alternative au marasme ambiant passe donc par l’industrie du divertissement. Là aussi, les dégâts sont sérieux : Hollywood a presque mis la clé sous la porte, les grands studios se sont cassé les dents, la ligue nationale de baseball a dû évacuer quatorze équipes faute de fonds suffisants…
Mais le pays redresse la tête en jouant au Monopoly, introduit en 1935 (une banqueroute fictive reste préférable à une ruine réelle), en dansant le swing dans les cafés jusqu’à l’épuisement ou en écoutant les soap operas radiophoniques. Au cinéma, l’ambiance est à la bonne humeur de façade : musicals et comédies potaches triomphent, emmenées par l’audace des Marx Brothers, et Le Magicien d’Oz éclabousse le public en Technicolor. Moins pastel mais tout aussi populaire, le gangster s’impose sur les écrans comme une figure familière, cousin d’infortune des défavorisés de la période – une sorte de Robin des Bois au chapeau pork pie et au fusil-mitrailleur… Bref, par la force des choses, les peurs mais aussi les espoirs de l’époque marinent dans l’industrie de l’entertainment. Les comic books ne font pas exception.

Bat-Man – comme on l’appelle à ses débuts – est l’enfant de ces temps de misère. Il apparaît en mai 1939 (Detective Comics #27) dans une plaie ouverte par la Grande Dépression qui suppure encore : un personnage tourmenté par son passé, amer et violent, dont la détresse n’est pas matérielle mais morale. Orphelin à dix ans, il a mûri trop vite au milieu des ronces d’une enfance écorchée ; il devient un adulte aigri et solitaire, s’effaçant jusqu’à ne faire plus qu’un avec les ombres de sa ville natale.
Son terrain de chasse favori, à l’image des chauves-souris dont il a fait son emblème, c’est la nuit de Gotham, en particulier ses allées tortueuses fourmillantes de meurtres et de trafics en tous genres. La structure même de la ville fictive reflète une époque malheureuse et sinistrée, sorte de double maléfique des mégalopoles tentaculaires qui commencent à s’étendre sur le territoire américain, avec leurs rideaux d’autoroutes et de béton armé à perte de vue. Au centre de Gotham, le district mal famé des Narrows, hérissé de bidonvilles, rappelle l’architecture de bric et de broc de « Hooverville », quartier de tôle élevé par les déshérités de la Grande Dépression, et qui doit son nom au président de l’époque, Herbert Hoover. Le parallèle avec la Grosse Pomme, ville la plus durement touchée par la crise, est évident : Gotham est son surnom officieux depuis 1807. Il est emprunté à une ville homonyme située en Angleterre, dans le Nottinghamshire, et qui fut le théâtre d’un fait divers cocasse et semi-légendaire au début du XIIIe siècle : afin de s’épargner une visite du roi Jean, ses habitants auraient simulé la folie… De quoi inspirer les créateurs de Batman, qui imaginent une métropole au bord du chaos. Le scénariste du magazine, Bill Finger, l’admet sans difficultés : « nous ne l’avons pas appelée New York parce que nous souhaitions que chacun, quelle que soit sa ville, s’y identifie. » Et ça marche : dans les consciences, Gotham devient le refuge des malheureux de tous horizons, un nid de guêpes où chacun peut projeter ses terreurs et ses frustrations.
Batman vs. Superman
Rappelons que Batman n’est pas le premier-né de cet univers. Un an plus tôt, en 1938, Superman faisait une arrivée tonitruante dans les kiosques américains. Inséré négligemment entre plusieurs planches du magazine Action Comics #1 – aujourd’hui considéré comme le comic book le plus précieux au monde –, il est aussitôt adopté par son lectorat. L’histoire d’un extraterrestre accomplissant des miracles au service de la planète Terre redonne du cœur aux Américains moroses : pour transformer l’essai, ses éditeurs lancent Batman dans la brèche quelques mois plus tard. Mais les différences entre les deux œuvres sont assumées. Là où Superman, son alter-ego de lumière, sauve la veuve et l’orphelin avec sa vision à rayons X et son ouïe surdéveloppée, Batman s’enfonce dans la nuit armé de sa seule soif de vengeance. Dans le premier numéro qui le voit apparaître, il jette sans ménagement un criminel dans une cuve d’acide. « Une fin digne de lui » conclut-il, lapidaire… En un an, le « chevalier noir » épinglera une vingtaine de malfrats à son tableau de chasse.

Autre point de divergence entre les deux œuvres : Superman est un extraterrestre, inscrit dans le répertoire de la science-fiction avec des accents bibliques (son nom de baptême, Kal-El, signifie « la voix de Dieu » en hébreu). Moins haut en couleur, Batman est un détective de film noir modelé sur les nouvelles de Poe ou de Conan Doyle et qui partage, par son traumatisme originel, les souffrances de millions d’Américains. Car l’inspiration originale de Batman se situe du côté de Zorro, archétype du hors-la-loi acclamé par les classes pauvres, et doit énormément à l’interprétation de Douglas Fairbanks dans Le Masque de Zorro (1924). Au commencement, donc, Batman était blond et empruntait au collègue Superman ses collants rouges… Après avoir aperçu un croquis de la machine volante imaginée par Léonard de Vinci au XVe siècle, le scénariste Bill Finger le grimera en chauve-souris – ailes comprises – et lui rendra un peu de sobriété.
Malgré ces différences, ces deux personnages représentent un aboutissement du rêve américain. Ils sont imaginés par des immigrés ou des descendants d’immigrés : ce n’est pas un hasard si leurs héros transcendent les difficultés de leur passé – la destruction de Krypton pour l’un, le meurtre de ses parents pour l’autre – et se détachent de leurs racines pour mener leur propre combat. En cela, ils copient l’état d’esprit de nombreux Américains laissés pour compte après le séisme de la Grande Dépression. L’identité double Bruce Wayne/Batman et Clark Kent/Superman permet cette sublimation : considérés comme des individus ordinaires dans le civil, ils deviennent extraordinaires sous l’anonymat de la cape. Cette élévation ressemble à un défi proposé à toutes les classes laborieuses convalescentes de la crise de 1929.

En outre, l’idéal justicier de Batman, plus encore que celui de son compère à collants, témoigne du pic de criminalité enregistré dans les mégalopoles américaines sous la Prohibition. Dans les années 1920, l’interdiction de vendre de l’alcool a dopé la contrebande et les trafics : des pointures du grand banditisme telles Al Capone, John Dillinger, Machine Gun Kelly, Clyde Barrow et Bonnie Parker se font connaître dans ce contexte troublé, souvent considérés avec indulgence voire affection par l’opinion publique. Batman n’est pas de cet avis : « les criminels sont lâches et superstitieux, il faut que je trouve un moyen d’inspirer la peur » grogne-t-il.
Ce n’est pas pour autant qu’il se lance dans des représailles personnelles : il préfère couper le mal à la racine en dénouant les nœuds criminels qui étranglent la ville. En cela, il rappelle la croisade policière entreprise par le président Roosevelt qui donne les pleins pouvoirs au FBI au début des années 1930, permettant de jeter la pègre de New York, de Chicago et d’ailleurs sous les verrous. Les cinq barons du crime cités plus haut sont tous écroués ou liquidés avant 1935, et le grand public comme le cinéma glorifient désormais les « G-Men », hommes du gouvernement dirigés d’une poigne de fer par John Edgar Hoover, le patron du FBI (lequel fera d’ailleurs plusieurs apparitions aux côtés des gentils de l’univers de Batman, partageant l’affiche avec l’homme-chauve-souris en janvier 1942). A travers Batman, le pays se réconcilie aussi avec ses autorités et caresse l’espoir d’une paix civile retrouvée. D’autant que le monde marche désormais vers la guerre…
Batman forever
Vedette du cinéma et de la bande dessinée, Batman est l’enfant de la misère des années 1920-1940 durant lesquelles les Américains n’avaient pour horizon que les toits en tôles des bidonvilles ou la petite criminalité des alambics clandestins. C’est sans doute le désordre civil de la période qui a conduit le personnage à assumer un comportement si brutal envers la pègre. De manière assez surprenante, son acolyte Robin “The Boy Wonder” a été introduit à ses côtés pour tempérer la violence du chevalier noir à une époque où l’Amérique blêmissait de savoir ses enfants lire, dans le secret de leur couette, des bandes dessinées esthétisant le crime, la violence, et les demoiselles en détresse et en petite tenue… Ironiquement, l’arrivée de Robin créera une nouvelle polémique : taxé d’homosexualité passive (nous sommes alors en pleine « peur violette », une croisade homophobe menée depuis les plus hauts échelons du gouvernement américain), le protagoniste inquiètera encore davantage les parents et ne parviendra jamais à atteindre le niveau de respectabilité et de popularité de Batman. A l’image du Bat-Signal, dont l’éclat crève les ténèbres de Gotham, le personnage du justicier vengeur demeure un phare dans la nuit de la Grande Dépression, l’expression populaire d’un espoir venu du caniveau et qui ne meurt jamais. Et qui murmure aux masses : dormez tranquilles, tout ira mieux demain. Le chevalier noir veille.
Ce chapitre est extrait de Godzilla est né à Hiroshima : la vraie histoire des icônes de la pop culture, paru chez First le 12 septembre 2024. S’attardant sur 30 héros et héroïnes de la culture pop – de Wonder Woman à Frankenstein, de La Belle au bois dormant à Dracula – ce livre explore la réalité dissimulée derrière la fiction… Plus d’infos ici.